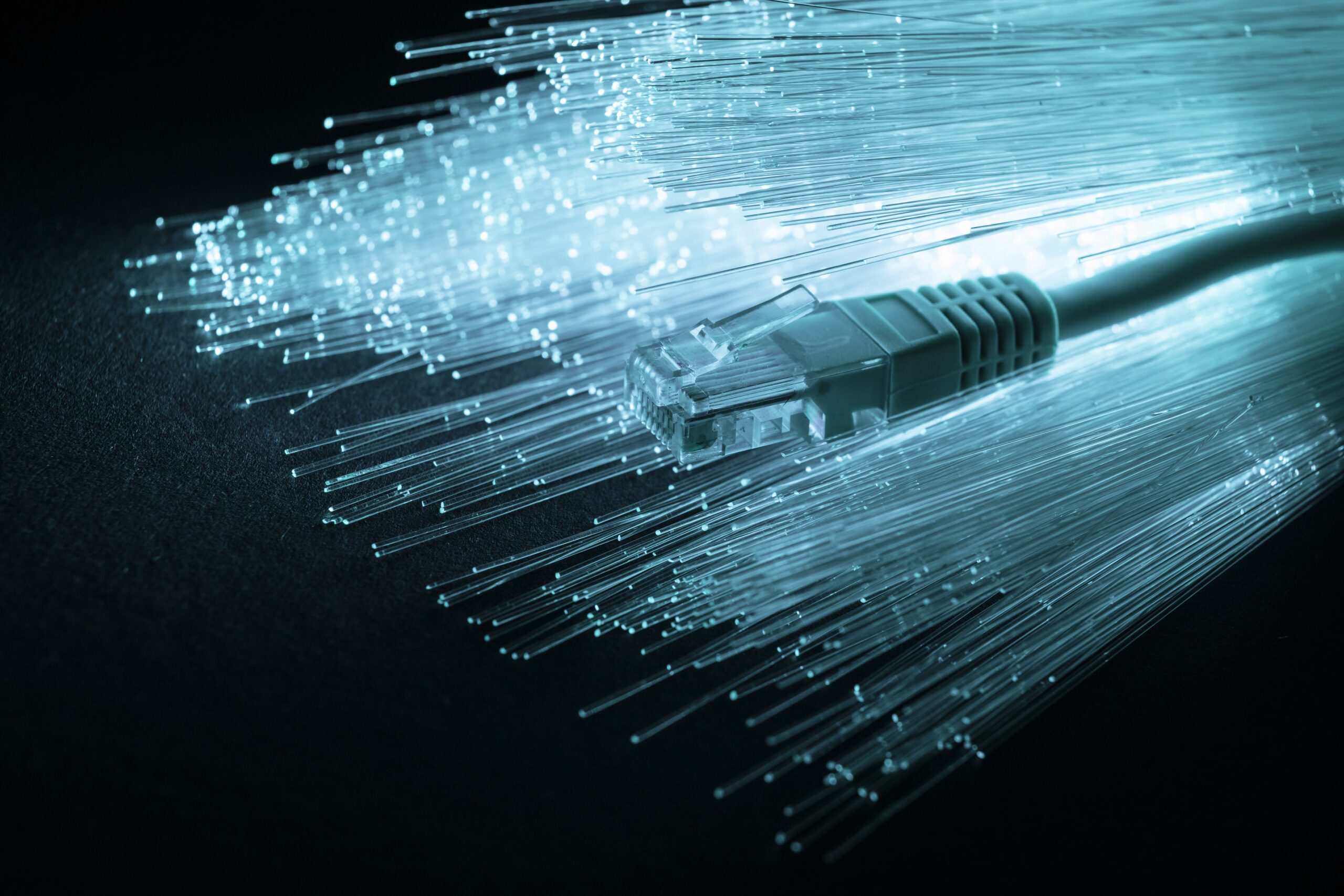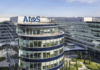Après 600 jours de conflit, Israël conserve une étonnante solidité économique. Mais cette résilience a un coût social et humain croissant, selon l’économiste Jacques Bendelac.
Une économie de guerre taillée pour la survie
Depuis sa création, Israël s’est bâti sur un paradigme unique : celui d’une économie capable de fonctionner sous la pression permanente de la guerre. Jacques Bendelac, spécialiste de l’économie israélienne, évoque un « modèle unique au monde » qui a su conjuguer production, innovation technologique et sécurité nationale. Cette organisation repose sur une flexibilité institutionnelle, un tissu entrepreneurial solide et une culture de l’urgence, inscrite dans la durée.
Au cœur de cette résilience, un trésor de guerre : les 210 milliards de dollars de réserves de la Banque d’Israël. Alimentées en partie par les revenus du gaz naturel, ces ressources pourraient — selon Bendelac — financer une guerre pendant dix années. Ce chiffre symbolise autant la robustesse du système financier que l’ampleur de l’effort budgétaire dédié à la défense nationale. Un arsenal économique dissuasif, mais non infini.
L’économie israélienne continue de fonctionner, mais sous contrainte. La production industrielle s’ajuste, les exportations résistent, et l’innovation technologique reste active, notamment dans les secteurs liés à la défense et à la cybersécurité. Toutefois, cette résistance repose sur un fragile équilibre : la stabilité des marchés, la confiance des investisseurs, et l’absence d’extension du conflit à grande échelle.
Le coût intérieur d’une guerre sans fin
Si l’économie globale tient, la population, elle, s’essouffle. L’année 2024 est, selon Bendelac, « la plus mauvaise depuis 40 ans » sur le plan économique. La hausse continue des prix, l’envolée des taux d’intérêt et l’alourdissement de la fiscalité étranglent les classes moyennes. Le conflit pèse sur la consommation, sur l’investissement privé et surtout sur le moral des ménages.
Les populations du nord et du sud, les plus exposées aux hostilités, sont également les plus fragiles sur le plan économique. Appauvrissement, pertes d’emplois, destructions d’habitations : le conflit amplifie les inégalités territoriales et sociales. Des milliers d’Israéliens doivent être indemnisés, hébergés, soutenus, mettant à rude épreuve les dispositifs de solidarité.
Deux piliers essentiels de l’économie israélienne — l’agriculture et le tourisme — sont à l’agonie. L’incertitude sécuritaire a vidé les hôtels, les sites religieux, les marchés. Les agriculteurs, souvent proches des zones sensibles, peinent à maintenir leur production. Cette désorganisation sectorielle risque de laisser des cicatrices durables sur l’économie réelle.
Entre espoir économique et dépendance militaire
Malgré tout, Jacques Bendelac reste confiant : en cas de cessez-le-feu durable, l’économie israélienne pourrait rebondir rapidement. La demande intérieure repartirait, les flux touristiques reviendraient, et les investissements étrangers pourraient affluer à nouveau. L’histoire économique d’Israël montre que les périodes de guerre ont souvent été suivies de croissances soutenues.
L’économiste salue l’approche « business-oriented » de Donald Trump, pour qui l’argument économique prime dans toute négociation stratégique. Cette perspective, bien que controversée, repose sur une idée simple : il est plus coûteux de faire la guerre que de conclure un accord. Selon Bendelac, cette logique pourrait s’imposer dans le dialogue régional, y compris face à l’Iran.
Enfin, Bendelac insiste sur un impératif : « que l’économie reprenne le dessus sur le militaire ». Car si Israël a su survivre économiquement dans la guerre, ce modèle n’est pas soutenable indéfiniment. Replacer la prospérité collective, la justice sociale et le développement à long terme au cœur du projet israélien est la condition d’un avenir viable — et d’un espoir de paix durable.